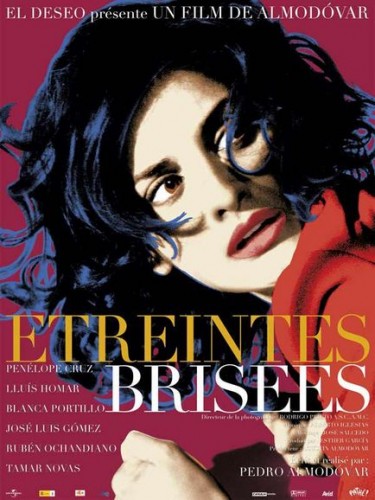Pour en savoir plus sur ce blog et sa créatric: CV, contact, partenariats ...
Critique de PERFECT DAYS de Wim Wenders - Compétition officielle 2023

Je dois vous le dire d’emblée car je sais l’attention volatile et il serait dommage que vous passiez à côté de ce film que j’ai follement aimé : ce nouveau long-métrage de Wim Wenders est une merveille qui met le cœur en joie. Le bruissement des feuilles. Le reflet des ombres. L’architecture des bâtiments de Tokyo. Les rayons du soleil qui éclaboussent la ville de lumière. Dans ce film, tout est poésie, ode à l’instant et à sa fragilité, à la singularité de l’être, au pouvoir de l’art et plus spécifiquement de la musique pour le sublimer, comme la célèbre chanson de Lou Reed dont s’inspire le titre.
Ces « perfect days » sont ceux d’Hirayama (Koji Yakusho) qui travaille à l’entretien des toilettes publiques de Tokyo. Une vie simple. Un quotidien très structuré que la caméra scrute avec minutie et douceur, le suivant dès l’aube dans ses rituels qu’il accomplit avec une régularité métronomique, et accompagnant son regard sur les livres, et les arbres qu’il aime photographier. Son passé va nous être conté par bribes au gré de rencontres inattendues qui apportent un éclat nouveau à sa personnalité : la riche famille qui méprise son quotidien et avec laquelle il a rompu, cette nièce qui lui ressemble tant, cette femme qui ne le laisse pas insensible, son bonheur contagieux à écouter ses cassettes, à s’occuper de ses plantes, à photographier le même arbre sur lequel rebondissent les rayons du soleil ou à lire (Faulkner ou Patricia Highsmith) avant de céder au sommeil.
Le film a pour origine une lettre reçue par le cinéaste en 2022 qui lui disait ceci : « Seriez-vous intéressé par le tournage d'une série de courts métrages de fiction à Tokyo, peut- être 4 ou 5, d'une durée de 15 à 20 minutes chacun ? Ces films traiteraient tous d'un projet social public extraordinaire, impliqueraient le travail de grands architectes et nous nous assurerions que vous puissiez développer les scénarios vous-même et obtenir la meilleure distribution possible. Et nous vous garantissons une liberté artistique totale. » Si au mot architecture (a fortiori de toilettes publiques) vous associez la froideur, détrompez-vous, tout ici est à l’image d’Hirayama : inondé de chaleur. Le regard que ce dernier porte sur la vie et les autres est empreint de sérénité et d'empathie, et traverse l’écran pour nous envelopper de son aura lumineuse, poétique, délicate. Réconfortante. Le spectateur épouse alors son rythme, et trouve dans la répétition de ses journées, jamais ennuyeuse à vivre pour lui, une paix consolante.
Le film entier est jalonné de tubes des années 60-70 qui exaltent la beauté de l’instant et font surgir la magie, et l’émotion. Le personnage principal incarné par Koji Yakusho ne parle pas une bonne partie du film mais la quiétude qui émane de son visage en dit tellement de son bonheur d’être là que toute parole serait redondante. Koji Yakusho mériterait d'être récompensé pour ce rôle si solaire de cet homme souvent méprisé, mais attentif à tout et tous, dont de petites touches (de rencontres, de rêves, de regards, de silences) nous révèlent le passé et l’émouvante personnalité. Wim Wenders est d’ailleurs un habitué de la Croisette qui l’a souvent récompensé : Prix de la critique internationale pour Au fil du temps, Palme d'or, Prix de la critique internationale et le Prix du jury œcuménique pour Paris, Texas, Prix de la mise en scène pour Les Ailes du désir, Grand prix du jury pour Si loin, si proche !, et Prix spécial du jury Un certain regard, Mention spéciale du jury œcuménique et Mention spéciale du Prix François-Chalais pour Le Sel de la Terre.
Le dernier plan, d’une grâce infinie, sur la musique de Nina Simone avec le visage d’Hirayama illuminé de lueurs, changeantes comme ses expressions, justifie son prix à lui seul et nous fait quitter la salle encore sous le charme de ce moment hors des trépidations de la vi(ll)e.
Cette promenade poétique dans une époque agitée, qui pourrait sembler de prime abord d’une apparente banalité, s'apparente à un conte philosophique d’une grande profondeur, magistralement écrit par Wim Wenders et Takuma Takasaki (avec aussi un magnifique travail sur le son et la lumière) dont on ressort avec l’envie de contempler tout ce qui nous environne, de se laisser caresser par les rayons du soleil, de les admirer inlassablement lorsqu’ils percent à travers les feuilles des arbres, de rouler en écoutant à tue-tête la musique des années 80 (The Animals, Patti Smith, The Rolling Stones, Lou Reed, The Velvet Underground, Otis Redding, The Kinks, Van Morrison :…rien que ça !), de se laisser transporter par cette bouffée jubilatoire et d’y puiser un invincible optimisme, une croyance en tous les possibles de l’existence que ce film esquisse avec une infinie délicatesse.