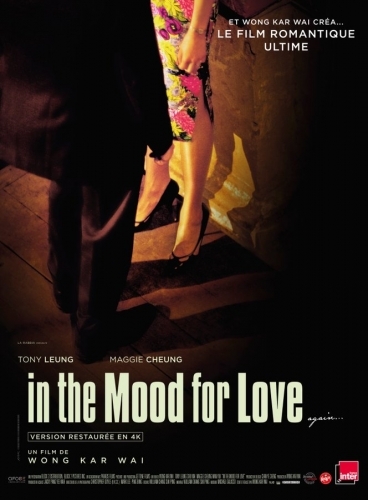Pour en savoir plus sur ce blog et sa créatric: CV, contact, partenariats ...
LETTRE D'UNE INCONNUE de MAX OPHÜLS - Cannes Classics 2021

Quel plaisir de revoir Lettre d’une inconnue de Max Ophüls au cinéma. Ce film fait partie de la sélection Cannes Classics 2021 et ressortira sur les écrans le 9 février 2022, restauré en 4K.
La nouvelle de Zweig dont le film d’Ophüls est la libre adaptation parut pour la première fois sous le titre Der Brief einer Unbekannten (La Lettre d’une inconnue) le 1er janvier 1922, dans le quotidien viennois Neue Freie Presse. Ce texte a ainsi été adapté 7 fois au cinéma. Ophüls l’adapta en 1948. Trois cinéastes l’adaptèrent même avant lui (Alfred Abel, John M.Stahl et Hannu Leminen). Parmi les autres adaptations, plus récentes, figurent notamment celle de Jacques Deray en 2001 ou encore celle de la réalisatrice chinoise Jinglei Xu en 2004.
« Quand vous lirez cette lettre, je serai peut-être morte. » Ainsi, par cette phrase qui place d’emblée le récit sous le sceau de la tragédie, débute la lettre que son valet de chambre remet à Stefan Brand (Louis Jourdan), ex-pianiste célèbre, de retour d’une soirée. Nous sommes à Vienne dans les années 1900 et, par une nuit pluvieuse, un carrosse a ramené chez lui cet homme fatigué. Cette lettre est celle d’une inconnue qui se nomme en réalité Lisa Berndle (Joan Fontaine). Il commence à la lire sans imaginer une seconde l’histoire dramatique qu’elle recèle, celle d’une patiente à l’agonie qui a recouru à ses dernières forces pour lui écrire cette longue missive, l’histoire de sa vie. Quelques heures plus tard, à l’aube, il est censé affronter en duel un mari trompé. Il n’a aucune intention d’honorer ce rendez-vous. Commence alors en flashback le récit poignant et terrible de cette passion inconditionnelle, obsessionnelle et à sens unique. Le spectateur, par la voix off de Lisa, va alors suivre trois périodes de son existence, uniquement vécues par le prisme de cet amour éperdu, de sa première rencontre à 15 ans avec ce pianiste promis alors à un avenir radieux qui emménage juste à côté de chez elle jusqu'à leur dernière rencontre alors que son piano n’est désormais plus qu’un objet de décoration et que la musique ne fait même plus partie de sa vie.
Si les adaptations de la nouvelle de Zweig furent nombreuses, celle d’Ophüls a marqué l’histoire du cinéma car, mieux que quiconque, il su adapter et s’adapter à l’œuvre romantique de l’écrivain autrichien épris de psychanalyse. Ophüls donne ainsi un nouvel éclairage au travail littéraire de Zweig, lui apportant une dimension supplémentaire, comme il l’avait fait auparavant avec celui d’Arthur Schnitzler pour La Ronde et celui de Guy de Maupassant pour Le Plaisir. Pour cela, il a collaboré avec Howard Koch dans l'écriture du scénario. Ainsi, dans cette adaptation, l'écrivain du livre (sorte de double de Zweig) devient, dans le film, un pianiste talentueux mais perfectionniste et insatisfait, un séducteur impénitent, domaine de la séduction dans lequel il semble finalement avoir beaucoup plus d’assurance que dans celui de la musique. Dans l’adaptation d’Ophüls, à la lecture de la lettre de Lisa, il va peu à peu prendre conscience de son aveuglement. La fin diffère ainsi de celle du livre.
Lettre d’une inconnue est le deuxième film américain de Max Ophuls après L’Exilé (1947), un film de cape et d'épée avec Douglas Fairbanks Jr. Emigré à Hollywood, il lui fallut ainsi attendre six ans après son arrivée aux USA pour pouvoir s’atteler de nouveau à la réalisation d’un film. On remarque au passage qu’au générique du film, le cinéaste est crédité sous le nom "Max Opuls".
S’il fallait trouver des termes pour qualifier le cinéma d’Ophüls, ce serait certainement le mouvement et l’écho (les jeux de correspondances et de miroirs), cette ronde perpétuelle de la vie. Ainsi, Lisa ne cesse de déambuler dans Vienne pour trouver Stefan. Stefan lui aussi déambule, entre Vienne et Milan. Leur fils lui aussi partira en voyage, pour un voyage sans retour. Les personnages semblent être constamment dans l’évanescence, l’instabilité, l’incertitude, en proie aux rouages impitoyables et carnassiers du destin qui les conduit inexorablement vers la mort tragique comme le seront aussi Madame de... et Lola Montès. Ce mouvement se traduit par des longs plans séquences d’une virtuosité et d’une fluidité admirables.
La réalisation n’est pas que mouvement. Elle traduit aussi l’isolement, l’enfermement de Lisa dans son illusion, souvent dans l’embrasure des portes, souvent en observatrice du monde, souvent derrière des rideaux. Il y a aussi cette cage d’oiseau lorsque sa mère lui annonce qu’elles vont devoir partir car elle va se remarier. Lisa est dans sa prison de rêves, coupée du monde, coupée de la réalité et coupée des autres. Le seul personnage qui la voit et l’entend, le valet de l’artiste, ne parle pas. Comme elle, il est perpétuellement placé dans l’attente. Le premier rendez-vous amoureux entre Stefan et Lisa, à l'intérieur du train du parc d'attractions au Prater à Vienne met aussi en scène une illusion. Ils parcourent plusieurs pays et lieux comme Venise ou les Alpes Suisses qui ne sont alors que des toiles peintes défilant derrière la vitre du wagon. Et le baiser qu’ils se donneront, comme s’il n’était là aussi pas réel, ne sera pas montré à l'écran. La subtile mise en scène d’Ophüls instille ainsi de la mélancolie et donne cette impression de brouillard qui auréole la réalité d’un voile onirique.
Il recourt ainsi également beaucoup au jeu des miroirs, des correspondances, de la symétrie des scènes. Lisa dit ainsi deux fois adieu à la gare, une fois à l'homme qu’elle aime passionnément, et dix ans plus tard à son fils. Les deux fois, elle est censée les revoir 15 jours plus tard. Les deux fois, la fatalité en décidera autrement. Les scènes d’escalier sont aussi nombreuses, des escaliers en spirale comme s’ils matérialisaient une autre spirale infernale, celle du destin. Il y a cette mémorable séquence dans le hall de l'opéra de Vienne. Mais aussi cette fois où Stefan est filmé deux fois sous le même angle, en plongée du haut de l'escalier. Les deux fois, il est accompagné d’une femme. La première fois, il est vu par Lisa, alors adolescente qui, depuis le haut de l’escalier, le voit ramener une femme chez lui, la femme du soir ou du moment. La deuxième fois, des années plus tard, c’est Lisa qui l’accompagne. La mise en scène nous signifie ainsi qu’elle n’est qu’une femme parmi d’autres. Tout n’est que question de point de vue semble nous dire Ophüls, cette symétrie suggère ce que Lisa, dans son illusion romantique, ne veut pas encore voir, et préfigure l’effroyable désillusion qui l’attend.
Lettre d'une inconnue est aussi la troisième collaboration d’Ophüls avec le chef-opérateur Franz Planer. Et la lumière apporte aussi un autre éclairage au récit, notamment lorsque, par une lumière expressionniste, Stefan ressemble soudain à un vampire comme un écho (encore un) à cette scène, devant une vitrine de mannequins en cire lors de laquelle Lisa se demandait si l'on ferait un jour un personnage de cire de Stefan,
Ophüls joue et jongle habilement et malicieusement avec les regards et les points de vue. Si le point de vue est celui, amoureux et aveuglé, de Lisa, la mise en scène révèle un tout autre visage de Stefan, celui d’un homme égoïste, désabusé, vide qui ne se souvient absolument pas d’elle et qui ne la voit que lorsqu’elle est à jamais disparue. Le splendide et historique fondu enchaîné qui fait superposer le visage de Stefan à celui de la jeune femme qui les réunit alors qu’il est trop tard est empreint d’une rare force nostalgique, bouleversante.
Grâce a sa mise en scène, aux jeux des points de vue, de lumière et de symétrie, Ophüls a apporté à la nouvelle de Zweig un supplément d’âme mais aussi grâce à ses deux interprètes qui ont à jamais immortalisé les héros de la nouvelle. Un film qui nous emporte dans son vertige amoureux, une valse tragique et bouleversante à revoir absolument et à ajouter à la liste des autres chefs-d’œuvre du cinéaste que sont La Ronde, Le Plaisir, Madame de... et Lola Montès.